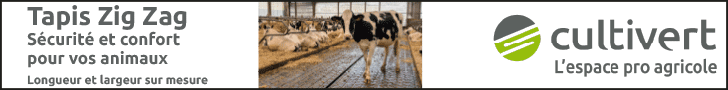Julien Colin s’est installé avec son cousin Yannick Gauvin en 2011. Ils conduisent aujourd’hui un troupeau de 80 vaches laitières (3/4 en Prim’Holstein et 1/4 en Normande). La conversion en bio faisait partie du projet d’installation, elle a été débutée en 2012. « Nous avions suffisamment de surfaces, la conjoncture était porteuse et la Cuma locale avait déjà investi dans des équipements spécifiques au bio », ont souligné les associés lors d’une porte ouverte organisée sur l’exploitation le 4 septembre. Les producteurs ont fait le choix de commercialiser leur lait à Biolait, « se reconnaissant dans les valeurs de transparence de l’entreprise ».
Un audit global réalisé
Mais des difficultés sont apparues à partir de 2021 avec une conjoncture difficile en lait bio, et suite à une décision du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine liée à la vétusté du pont de Port de Roche : l’autorisation de poids maximal pour le franchir a été abaissée à 3,5 t. « Alors que nos 2 sites de production étaient espacés de 8 km en passant par le pont, il fallait faire 34 km aller-retour pour rejoindre le site des génisses en tracteur. »
Déménagement des génisses dans un bâtiment neuf
Les éleveurs font le choix d’échanger des terres avec un autre agriculteur : 33 ha contre 36,5 ha à proximité de leur siège, mais de moins bon potentiel. En mars 2024, ils décident de construire un nouveau bâtiment génisses près de la stabulation et profitent de ce « gros changement structurel » pour réaliser un audit global avec Frédéric Touchais, consultant ‘stratégie et projet’ chez Eilyps. Un accompagnement appuyé par Eaux & Vilaine qui souhaite voir maintenu ce type d’élevages sur une zone où la qualité de l’eau est préservée.
« Les résultats technico-économiques antérieurs montraient une production/vache laitière inférieure au potentiel et un TP inférieur à 31. Et sans modification de l’assolement, il y aurait eu une perte de 60 t MS de fourrage », précise Frédéric Touchais. « Les éleveurs utilisaient des fourrages de qualité mais en flux tendu et il y avait une sous-ingestion au pâturage : 14,5 kg MS au lieu de 16 kg MS recommandés. »
Le système a été revu en raisonnant en MCA/VL (marge sur coût alimentaire). « Conserver 70-80 vaches nous convient par rapport au nombre de places au cornadis et pour maintenir une durée de traite à 1 heure », précisent les agriculteurs.
Un nouvel assolement
Les 12 ha d’ensilage de maïs sur 136 ha de SAU ont été gardés, la surface de luzerne est passée de 4 à 13 ha et la surface en méteil grain autoconsommé par les bovins a été accrue (vente de 19 ha de méteil grain auparavant). La gestion de l’herbe a aussi été recadrée et les génisses sont passées en pâturage tournant. « Nous avons par ailleurs investi dans du correcteur azoté bio : à hauteur de 1 kg/VL en moyenne sur 4 mois de l’année ». Toutes ces adaptations, générant une hausse de marge nette de 15 000 €, ont permis aux éleveurs de pérenniser leur exploitation.
Agnès Cussonneau
Une gestion plus fine du pâturage
« Pour le pâturage des 75 vaches laitières en moyenne, les paddocks ont été réorganisés, faisant 90 ares avec emploi d’un fil avant. Désormais, les vaches entrent à 12-13 cm de hauteur d’herbe et ressortent à 5-6 cm », souligne Juliette Perrigault, conseillère Eilyps intervenant sur l’élevage. Avec un accompagnement d’Eaux & Vilaine, 4 km de haies ont été implantés, 2 km supplémentaires vont suivre, permettant la protection des animaux et des cultures. Plusieurs types de haies ont été mises en place : à plat, sur billon, sur 2 rangs. « Deux rangs en quinconce permettent d’éviter d’avoir un talus, c’est plus facile à entretenir », explique Yannick Gauvin. « Du semis a également été réalisé sur une petite partie. Cela consiste à mettre en terre en forte densité de graines du secteur, une technique moins onéreuse sans besoin de protection des plants », détaille Guillaume Cosson, technicien bocage. Les producteurs ont également mis en place 10 ha d’agroforesterie.