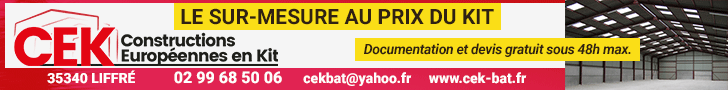Le mouvement s’est nettement accéléré ces quatre dernières années (- 5,3 %), un rythme deux fois plus rapide qu’à l’échelle nationale. En 2024, les prairies permanentes ne couvrent plus que 371 000 ha, soit 13,5 % du territoire régional, contre 19 % en moyenne en France. Leur part chute à 12,4 % dans les Côtes-d’Armor et atteint 14,4 % dans le Finistère.
Moins de bovins, moins de prairies
Ce recul accompagne la baisse du cheptel bovin (- 2,6 % par an depuis 2019) et la disparition continue d’exploitations. Les reprises entraînent souvent le retournement des prairies, la parcelle étant remise en culture, le plus souvent en maïs. Entre 2022 et 2023, près de 22 000 ha ont été retournés contre 18 000 ha seulement devenus permanents, soit un déficit net de 3 700 ha.
22 000 ha retournés entre 2022 et 2023
Les agrandissements d’exploitations, notamment laitières, jouent aussi un rôle. « Les parcelles reprises sont parfois éloignées des bâtiments d’élevage et plus facilement converties en maïs », précise la Draaf. Dans les grands troupeaux, la place de l’herbe diminue : au-delà de 130 vaches laitières, les exploitations comptent autant de maïs que de prairie, contre 1,8 hectare de prairie pour 1 hectare de fourrages annuels dans les structures plus modestes.
Des fonctions environnementales
La Bretagne se distingue par la place importante des cultures fourragères : 17 % de prairies temporaires et 19 % de maïs fourrage dans la SAU régionale, les taux les plus élevés de France. La spécialisation laitière et l’intensification des systèmes fourragers expliquent cette configuration. En parallèle, la surface moyenne des exploitations croît rapidement (+ 10 % en quatre ans), tandis que la part de prairies permanentes recule.
Si l’élevage bovin reste le principal garant du maintien des prairies, son évolution vers des systèmes plus grands et plus intensifs n’y contribue pas. Or ces espaces herbacés remplissent des fonctions essentielles : stockage du carbone, filtration de l’eau, préservation de la biodiversité et richesse paysagère. La Bretagne, région bocagère, voit ainsi se fragiliser un maillon central de son équilibre écologique.« Leur disparition fragilise à la fois l’autonomie fourragère des fermes et la régulation naturelle des milieux », conclut la Draaf. Le maintien d’un élevage herbager diversifié apparaît désormais comme un enjeu agricole et environnemental majeur pour la région.
Un garde-fou contre le retournement
La règle BCAE 1 de la Pac impose à chaque région de maintenir un ratio stable de prairies permanentes sur la surface agricole utilisée. Si ce ratio chute au-delà d’un seuil fixé, les autorités peuvent interdire tout nouveau retournement, voire imposer la réimplantation des surfaces perdues. Ce mécanisme de « frein d’urgence » vise à éviter une érosion irréversible du couvert herbacé. Il complète d’autres dispositifs incitatifs, comme les éco-régimes ou les MAEC biodiversité, encourageant la gestion durable des prairies.