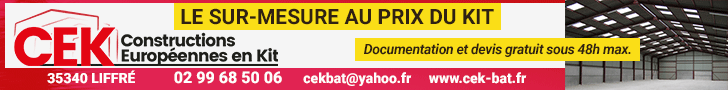Dominique Picard s’est lancé dans la production de tomate sous abri en 1997. Il a rapidement été rejoint par Jacques, son frère, en construisant une serre de 1,3 ha, pour de la tomate « en vrac et en grappe. L’objectif est de tirer le maximum de production au m2, il faut être compétiteur. Le challenge est d’y arriver avec le minimum de charges, il faut de la rigueur ». Depuis, la production s’est diversifiée, mais sans cultiver de petits fruits. Puis, les nouvelles variétés, les équipements, la technicité, l’expérience par des échanges et des comparaisons entre pairs ont fait bondir les rendements. « De 55 kg, nous sommes aujourd’hui arrivés à plus de 70 kg de tomate par m2 », chiffre le maraîcher de Penvénan (22).
Sur le plan énergétique « les serres sont vertueuses »
En 2007, le site s’agrandit d’un hectare supplémentaire, puis en 2010 la serre originelle de 1997 est réhaussée, pour monter de 3,75 m de hauteur à 5 m. Cette opération a été rendue possible par une entreprise spécialisée, qui a positionné des crics sur les poteaux existants pour remonter toute la charpente. Rehausser « n’agit pas que sur le rendement des plants, c’est aussi un confort de travail, on s’ouvre également un catalogue de variétés plus important, avec des végétaux plus longs ». Enfin, en 2015, une nouvelle structure de 0,5 ha est construite, avec une hauteur de poteau de 6,30 m. « Elle est beaucoup plus étanche, dotée de parois en polycarbonate. Avec plus de volume, on gagne en inertie, le climat est beaucoup plus homogène et plus sain ». Ce dernier édifice sorti de terre ne sert pour l’instant qu’à la production de tomate grappe. Ces travaux ont aussi été l’occasion d’installer un système de cogénération.


Des écrans pour économiser
Ces agrandissements ont été accompagnés d’investissements, notamment en matière d’économie d’énergie. Toutes les serres sont bien sûr équipées d’écrans thermiques. Sur le sujet énergétique, « nous avons connu une évolution, en passant du fioul lourd jusqu’en 2010, au gaz naturel. Les pratiques se sont beaucoup améliorées, les serres sont vertueuses ». Les écrans en toiture permettent d’économiser « 40 % d’énergie, et servent d’ombrage en été. Ces écrans ont une durée de vie de 10 ans environ ». Sur les parties latérales des abris, Dominique Picard a aussi installé des écrans. « Sans ce matériel, les parois attireraient davantage la chaleur et creuseraient le climat au milieu de la serre. Ces panneaux latéraux ont une double vocation : économiser l’énergie en hiver et occulter pour éviter d’avoir à blanchir en été ». Ces matériels s’enroulent sur eux-mêmes, ils s’ouvrent et laissent passer les rayons du soleil quand celui-ci est orienté au sud-ouest. Dans un souci d’évolution technologique permanent, le Costarmoricain réfléchit à installer différents capteurs, « car nous avons une diversité de tomates, qui ne se conduisent pas de la même façon. Sans capteurs, on est obligé de trouver une cote mal taillée ». Autre sujet important, celui du « Cultivées sans pesticides », « omniprésent sur l’exploitation, car demandé par le consommateur ».
Pour transmettre, il faut un bilan économique cohérent
Sur cette zone des Côtes-d’Armor, « un tiers des producteurs chauffe encore avec une chaudière à gaz classique, le restant est équipé de cogénération ». Le Gaec Picard en possède une, sous contrat avec EDF OA. Des panneaux solaires ont également été installés sur 2 bâtiments, pour un total de 250 kWc de capacité. Le premier bâtiment (87 kWc) sert à l’autoconsommation, le restant est revendu.
Sous abri et en plein champ
Le serriste est également président régional de la section tomate pour Prince de Bretagne. La transmission des exploitations est un thème qui lui tient à cœur, cette partie de la région est un peu particulière. « Dans de nombreux cas, les agriculteurs se sont lancés dans les cultures sous abri en complément de légumes de plein champ. Ce modèle est une force, y compris pour la coopérative et notamment pour les marchés ». Le Gaec dispose ainsi de 30 ha qualifiés de « complémentaires » aux serres. Les parcelles sont cultivées en blé ou en maïs. Cette dernière culture bénéficie en irrigation de l’apport des rejets de serre. Cette complémentarité plein champ sous abri permet d’obtenir « un système vertueux économiquement et environnementalement ». Un système résilient qu’il faut conserver, et des structures qu’il faut entretenir. « À l’époque de notre installation, nous partions avec des serres neuves. Aujourd’hui, les banques sont plus frileuses, du fait de l’augmentation des coûts de construction. Or, pour une bonne passation, il faut un bilan économique qui affiche des chiffres cohérents, en lien avec les investissements, même si ce n’est pas toujours évident de mettre la main à la poche en fin de carrière ». La coopérative à laquelle le Gaec Picard adhère s’est emparée de ce sujet de la transmission : « les Maraîchers d’Armor ont créé un poste dédié aux démarches d’installation » conclut-il.
Fanch Paranthoën
Les racines au chaud
Le système de production n’utilise étonnamment pas de gouttières suspendues. Les pains de laine de roche sont posés directement au sol. Dominique Picard trouve dans cette pratique un gros avantage au niveau agronomique : « Les tuyaux de chauffage se trouvent à proximité des racines. Avec une eau qui circule à une température entre 30 et 55 °C, la chaleur rayonne donc à 40 cm. La partie aérienne des plantes, nous la connaissons très bien ; il nous reste en revanche beaucoup à apprendre de la partie de la culture que l’on ne voit pas : le système racinaire ». Les pains de roche ont toujours été utilisés sur le site, « nous n’avons jamais changé, toujours dans une optique d’acquérir de l’expérience ».
Lutter contre le ToBRFV
Contre le virus du fruit rugueux brun (ToBRFV), « nous choisissons des variétés résistantes. Aujourd’hui, le nombre de segments couverts par la résistance augmente chaque année. Chez Prince de Bretagne, toute la gamme en grappe est à 100 % tolérante à ce virus, ceci pour sécuriser les volumes de production ». Autre sujet sanitaire, celui des aleurodes, les attaques ont été parfois très importantes cette année. Un levier naturel est utilisé par le maraîcher, il consiste à « garder les feuilles à la suite de l’effeuillage au sol. Ces feuilles apportent de l’humidité qui nous sert en été, et sont des refuges pour les auxiliaires ».