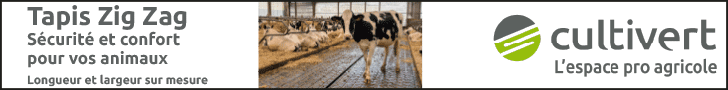ChÃĒteau de MarcillÃĐ-Robert (35)
Quâest-ce que la carpologie ? ÂŦ Câest la science qui ÃĐtudie les graines, fruits, noyaux, feuilles conservÃĐs et dÃĐcouverts dans un contexte archÃĐologique. Ces restes peuvent Être trÃĻs anciens, conservÃĐs sous forme carbonisÃĐe ou sous des limons par exemple Âŧ, explique Aurore Leroux, mÃĐdiatrice en archÃĐologie du CPIE (Centre permanent dâinitiatives pour lâenvironnement) Val de Vilaine.
Vendredi 18 juillet, aux pieds du chÃĒteau de MarcillÃĐ-Robert, elle intervenait auprÃĻs du grand public pour vulgariser cette discipline à lâintersection de lâarchÃĐologie, de la botanique, de lâethnologie et des sciences agronomiques. Un atelier organisÃĐ dans le cadre de lâÃĐvÃĻnement ÂŦ Mythes et Motte Âŧ.
Le carpologue nous renseigne sur l’agriculture, les ÃĐchanges…
ÂŦ GrÃĒce à ses recherches, le carpologue nous renseigne sur l’agriculture, les ÃĐchanges, l’environnement. Âŧ Lors de cet atelier ludique, les visiteurs ont pu imiter la dÃĐmarche scientifique de carpologie ÂŦ pour enquÊter sur ce que mangeait et cultivaient les populations du Moyen-Ãge en France Âŧ. Ils ont commencÃĐ par tamiser un ÃĐchantillon, puis ont triÃĐ les graines, les ont identifiÃĐes, quantifiÃĐes. Cet inventaire les amenait à dÃĐterminer le site oÃđ a ÃĐtÃĐ trouvÃĐ l’ÃĐchantillon. Ainsi, la prÃĐsence de graines de blÃĐ, millet, olive et avoine conduisait à un site sur Montpellier au 14e siÃĻcle.
Lâiconographie et les manuscrits
Aurore Leroux prÃĐsentait aussi dâautres types de âtracesâ laissÃĐes par nos ancÊtres du Moyen-Ãge, en lien avec lâagriculture et leur alimentation. ÂŦ Par exemple, des outils tout rouillÃĐs ont ÃĐtÃĐ retrouvÃĐs : des faucilles, des crocs à foin à deux dents… L’iconographie mÃĐdiÃĐvale ainsi que les manuscrits nous donnent aussi beaucoup d’informations sur le mode de vie des populations à l’ÃĐpoque. On les voit manger diffÃĐrents types de pains, rÃĐcolter des pommes, griller des chÃĒtaignes ou encore fouler les raisins avec leurs pieds. Des cochons sont reprÃĐsentÃĐsâĶ Âŧ, montre-t-elle sur des images. ÂŦ à lâÃĐpoque, les chevaux ÃĐtaient utilisÃĐs pour la traction ou la guerre, les bovins pour la viande, le lait ou les travaux des champsâĶ Âŧ
DÃĐcouverte des fouilles archÃĐologiques
Dans un autre atelier, les visiteurs ont pu dÃĐcouvrir la technique des fouilles archÃĐologiques. ArmÃĐs dâune balayette, dâune pelle, dâun pinceau et dâune truelle, ils ÃĐtaient invitÃĐs à faire apparaÃŪtre des objets placÃĐs dans des bacs et recouverts de sable, ÂŦ avec prÃĐcaution, pour ne pas les bouger et ne pas perdre des informationsâĶ Âŧ, comme l’explique un des mÃĐdiateurs bÃĐnÃĐvoles.
Quatre types de vestiges pouvaient Être sortis de terre : ceux de l’habitat seigneurial comprenant des pointes de flÃĻche, des carreaux de pavement, du mortier attestant d’un habitat d’ÃĐlite ; du forgeron (scories dâÃĐtain, fragment de fourâĶ) ; du potier (sole de four, tessons) ; du dÃĐpotoir avec des restes dâos, des coquilles d’huÃŪtres ou de moules, des tessons et un bouchon de pot. De quoi fournir de prÃĐcieux renseignements sur les modes de vie d’alors, dans le chÃĒteau ou dans la basse-courâĶ
ÂŦ Lors des fouilles archÃĐologiques, les fragments et restes trouvÃĐs sont rÃĐpertoriÃĐs. L’endroit, son emplacement, la profondeur, sont enregistrÃĐs trÃĻs prÃĐcisÃĐment. Aujourd’hui, les outils GPS facilitent les relevÃĐs topographiques. Âŧ
LâÃĐvÃĻnement ÂŦ Mythes et Motte Âŧ, qui sâest tenu les 18, 19 et 20 juillet, ÃĐtait organisÃĐ pour la premiÃĻre fois. ÂŦ Cela nous permet de tester les possibilitÃĐs d’accueil sur ce lieu autour du chÃĒteau de MarcillÃĐ-Robert Âŧ, indique Nicolas Rausch, directeur du service culturel à Roche aux fÃĐes CommunautÃĐ. Dâautres ateliers ont ponctuÃĐ ce long week-end, tels que la calligraphie, lâinitiation à la taille de pierre, lâarchÃĐozoologie, le tissage ou encore la conservation/restauration des chÃĒteaux-forts.


Le Moyen-Ãge se dÃĐvoile sur le territoire, aprÃĻs la prÃĐhistoire
Habituellement, mi-juillet, câest un autre ÃĐvÃĻnement qui est organisÃĐ sur la communautÃĐ de communes : la ÂŦ Semaine de la prÃĐhistoire Âŧ sur le site de la Roche-aux-fÃĐes, Ã EssÃĐ Ã proximitÃĐ, toujours en partenariat avec le CPIE Val de Vilaine. L’impressionnante allÃĐe couverte composÃĐe de 41 blocs de pierre attire chaque annÃĐe 25 000 visiteurs. Elle date du nÃĐolithique, soit environ 2 000 ans avant notre ÃĻre.
ÂŦ La valorisation du chÃĒteau de MarcillÃĐ-Robert permet aujourdâhui d’apporter un ÃĐclairage sur une autre pÃĐriode : le Moyen-Ãge. Âŧ Câest un chÃĒteau-fort en ruines, inscrit au titre des Monuments historiques, situÃĐ sur les Marches de Bretagne. AprÃĻs plusieurs ÃĐvÃĻnements cet ÃĐtÃĐ en lien avec le chÃĒteau, des visites guidÃĐes vont Être organisÃĐes lors des JournÃĐes du patrimoine, du 19 au 21 septembre, entrant dans le thÃĻme 2025 du ÂŦ patrimoine architectural Âŧ. ÂŦ Les gens pourront apprendre à lire les pierres Âŧ, indique Nicolas Rausch.
AgnÃĻs Cussonneau
Le chÃĒteau revit
AprÃĻs six ans de travaux qui ont permis la cristallisation des ruines du chÃĒteau de MarcillÃĐ-Robert, dans lâobjectif de conserver son ÃĐtat actuel, le site vient dâÊtre rouvert au public. Auparavant, une fortification en bois ÃĐtait prÃĐsente dÃĻs le 11e siÃĻcle rÃĐalisÃĐe par Riwallon. ÂŦ Câest probablement à AndrÃĐ III de VitrÃĐ (1173-1211) quâon doit lâÃĐdification de ce chÃĒteau en pierre dont la vocation ÃĐtait autant symbolique â il sâagit dâaffirmer sa puissance â que militaire Âŧ, soulignent les responsables. DÃĐpourvu de donjon, le chÃĒteau est constituÃĐ de six hautes tours trÃĻs resserrÃĐes, dont la plus haute mesure encore 11 m de haut. Renseignements : 06 67 35 65 96, tourisme@rafcom.bzh