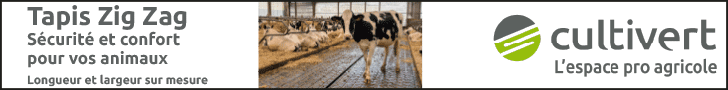Un temps radieux, un programme alléchant et quelque trois cents invités venus de toute la Bretagne… Voilà pour les ingrédients de base. Mais, comme dans toute « recette », ce qui fait la véritable réussite d’un événement tel que l’assemblée générale de la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole, c’est avant tout l’esprit qui l’anime.
Au sein de la CBCMA, il règne depuis toujours une saine ambiance associant convivialité, engagement et professionnalisme au service de l’agriculture bretonne. Et ce doux parfum a imprégné l’ensemble de cette édition 2025.
Être le partenaire d’une exploitation sur deux en Bretagne
Pour Dominique Trubert, le président de la Caisse de Bretagne, cette assemblée générale avait d’ailleurs une saveur toute particulière puisqu’elle se tenait à Pacé, sa commune natale. Invité par le journaliste Lionel Buannic à analyser l’exercice écoulé, le Bretillien évoque « une année de consolidation pour l’agriculture bretonne ». Si la situation mondiale a été marquée par des tensions géopolitiques persistantes et les fluctuations des prix des matières premières, les bases de l’agriculture régionale se sont, malgré tout, révélées solides et fiables.
Dans cet environnement mouvant, le cap de la CBCMA est resté clair. « C’est celui que nous avons défini dans le cadre de notre politique sectorielle agricole. Nous sommes pour une agriculture viable économiquement, vivable humainement et responsable sur le plan environnemental. Notre socle ne bouge pas ».

Des résultats commerciaux solides
Cette constance dans le soutien à l’agriculture bretonne porte ses fruits. Dominique Trubert dévoile ainsi des résultats commerciaux solides. « Les encours de crédits à moyen/long terme portés par le CMB sur le marché de l’agriculture ont progressé l’an passé de 3,4 % pour atteindre 2,145 milliards d’euros ». Quant au nombre d’agriculteurs détenant un Eurocompte, l’offre groupée de services « maison », il a, lui, augmenté de 0,5 %, ce qui est appréciable sur un marché mature. Mais le chiffre dont le président de la CBCMA est le plus fier reste assurément celui des jeunes agriculteurs accompagnés dans le cadre d’une installation aidée. « 164 JA ont choisi le CMB pour accompagner leurs premiers pas professionnels, soit une part de marché de plus de 38 % ! »
Se félicitant lui aussi de ces belles performances, Philippe Rouxel y voit l’illustration de la force de la CBCMA. « La Caisse de Bretagne, avec son conseil d’administration exclusivement composé de professionnels de l’agriculture, peut sembler insolite dans le paysage bancaire. Mais c’est ce qui la rend si pertinente. Au travers de ces élus, nous disposons de capteurs de terrain couvrant l’ensemble des territoires bretons, les diverses filières agricoles et les différents modes d’agriculture ». Un maillage fin qui assure une vraie proximité. Aux yeux du directeur général du CMB, par ailleurs directeur de la CBCMA, cette dernière incarne même la quintessence du modèle coopératif et mutualiste. « Le binôme administrateur-salarié, qui constitue l’un des atouts majeurs de notre organisation, y est particulièrement efficace ».
Une trajectoire remarquable
Rappelant que ce n’est qu’à partir de janvier 1990 – date à laquelle le monopole de la distribution des prêts bonifiés à l’installation a pris fin – que le CMB a pu lutter à armes égales avec son principal concurrent, Philippe Rouxel rend hommage aux anciens dirigeants de la Caisse de Bretagne. Des hommes qui, tels Amand Denieul et son successeur Christian Péron, ont mené avec force et passion le combat pour que les paysans bretons puissent choisir leur partenaire financier. « Si, aujourd’hui, nous pouvons être fiers de nos résultats en agriculture, c’est grâce à ces esprits pionniers ».
Il est vrai que la trajectoire agricole de la Fédération sur la décennie écoulée a belle allure. Alors que le CMB comptait 9 100 clients agriculteurs en 2015, il en dénombre quelque 10 500 aujourd’hui. Soit une augmentation de 1 400 nouveaux clients quand, sur la période, le nombre d’exploitations a diminué de 25 %. Le montant des encours de prêts accordés à l’agriculture a, lui, été quasiment multiplié par deux en dix ans. Autre chiffre symbolique : les 1 700 jeunes agriculteurs accompagnés depuis 2015. Un parcours remarquable que le CMB a su favoriser avec la mise en place d’une organisation facilitant la proximité.
Une promesse forte
Fort de ces réussites, le CMB s’est attelé à la rédaction de son nouveau plan à moyen terme pour le marché de l’agriculture. Résultant d’un travail de co-construction entre les élus de la Caisse de Bretagne et les salariés de la Fédération, ce projet stratégique à l’horizon 2030 identifie quatre enjeux majeurs : la rentabilité des exploitations, le renouvellement des générations, la souveraineté alimentaire et la transition environnementale. Le tout accompagné d’une promesse client forte : « Avec les agris, de toutes nos forces ! »
Cette feuille de route contient par ailleurs des objectifs chiffrés que Philippe Rouxel définit comme étant à la fois ambitieux et accessibles. Ainsi, dans cinq ans, l’établissement bancaire entend être le partenaire d’une exploitation sur deux en Bretagne, financer 40 % des installations de jeunes agriculteurs, atteindre une part de marché de 30 % sur les crédits à moyen-long terme et faire en sorte que le quart des financements accordés à l’agriculture soit dédié aux transitions.
Pour y parvenir, le CMB « fera feu de tout bois », annonce son directeur général. Recrutement et renforcement des expertises, développement des synergies au sein du Crédit Mutuel Arkéa, digitalisation, travail sur l’offre… « Le champ des possibles est ouvert, souligne Philippe Rouxel. Nous avons souhaité un plan optimiste. Notre vision est celle d’un futur construit avec et pour l’agriculture. Parce que c’est finalement bien là la vocation de la Caisse de Bretagne ! »
Jean-Yves Nicolas


Les atouts de la finance durable
En conclusion de cette assemblée générale, Julien Carmona évoque la finance durable. Une voie dans laquelle le Crédit Mutuel Arkéa s’est engagé volontairement dès la fin des années 2010. « On l’a fait parce que cela nous correspondait d’intégrer cette dimension de durabilité dans notre stratégie, précise le président de la Fédération et du groupe Arkéa. Il s’agissait pour nous, d’abord, d’une responsabilité morale. Et aussi de notre intérêt bien compris de banque qui est de financer les industries et les modèles de demain. La finance durable tire notre développement. C’est vrai pour le crédit comme pour l’épargne ».Le groupe, qui raisonne désormais en termes de performance globale, évalue son impact positif, en 2024, à plus de 9 milliards d’euros. « Cette mesure, établie à partir d’une série de paramètres, s’est enrichie cette année d’un indicateur sur l’autosuffisance alimentaire, calculé à travers notre soutien à la filière porcine ».Concernant l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire, le président du Crédit Mutuel Arkéa souligne combien les deux sujets sont liés, « le succès des uns fait le succès des autres ». Illustration concrète : la réalisation, financée par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, de la chaudière à biomasse de l’usine Laïta de Créhen (22), en partenariat avec Guyot Environnement. D’autres filiales, comme Arkéa Crédit Bail et Arkéa Capital, œuvrent elles aussi à la construction du futur de l’agriculture et de l’agroalimentaire.Julien Carmona termine son intervention par un « scoop » : la signature, par le Crédit Mutuel Arkéa, d’une nouvelle enveloppe de prêts garantis par le fonds européen d’investissement, dans le cadre de l’initiative nationale pour l’agriculture française (Inaf). D’un montant de 124 millions d’euros, elle sera destinée au renouvellement des générations, au développement des filières de qualité et à la transformation des modèles agricoles sur le plan des performances économique, environnementale, sociale et sanitaire.Autant d’initiatives qui traduisent la place centrale accordée par le CMB et le Crédit Mutuel Arkéa à l’agriculture et à l’industrie agroalimentaire.
« Réenchanter l’agriculture »
Pour le géographe Jean Ollivro, la Bretagne est confrontée à un paradoxe. Si elle est bien la première région agricole en Europe, le nombre d’exploitations y a diminué drastiquement, passant de 350 000 en 1950 à 25 000 aujourd’hui. « Les agriculteurs jouent un rôle économique crucial mais ils sont de moins en moins nombreux ». Eux qui représentaient 91 % des actifs au plan régional en 1911, ne pèsent plus que 2,3 % désormais. Une évolution qui a aussi des conséquences en termes d’image. « La représentation du monde paysan est de moins en moins appuyée sur des faits réels ». C’est le règne du café du commerce avec des visions sans nuances, déconnectées de la réalité. Avec pédagogie, l’universitaire souligne, lui, toute la puissance de l’agriculture régionale. « Elle suscite une cascade d’emplois. Près d’un tiers des emplois bretons lui sont liés. Et nos agriculteurs sont parmi les meilleurs au monde. Il faut en avoir la fierté ».Se plongeant dans l’histoire, il rappelle combien ceux qui découvraient la région étaient frappés par « sa fertilité. La Bretagne est un jardin ». Mais pillée par l’Etat – « Les taxes ont une importance majeure dans l’histoire bretonne » -, elle traîne une image de pauvreté. « Et d’une dévalorisation territoriale, l’on passe à la culpabilisation d’une identité avec le plouc breton et l’émergence de Bécassine au début du vingtième siècle ». La création de l’Office Central, le développement de la Jeunesse Agricole Catholique vont générer une nouvelle dynamique ascendante. Un réveil que symbolisera la création en 1950 du Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons (Celib).En s’appuyant sur les leçons du passé, Jean Ollivro identifie des pistes de réflexion pour l’avenir. Il lui semble ainsi primordial de travailler sur « le renouvellement des générations et de lutter contre les idées reçues en informant sur l’importance vitale de ce secteur ». La notion d’acceptabilité constitue également un axe de travail à l’heure où la société recense tant de « pumas », ces « projets utiles mais ailleurs ». Il invite aussi à plancher sur l’image et le vocabulaire qui ne sont pas en phase avec le quotidien d’un secteur au cœur de l’innovation. « Il faut souligner le rôle des paysans dans la production d’énergie, dans l’aménagement du territoire dont ils sont les piliers ». Lui prône la création d’un groupe « de 10 à 15 personnes, pour réenchanter et réaffirmer une vision de l’agriculture bretonne ». Et invite à renforcer les synergies dont il rappelle la définition : « action coordonnée de différents organes ». Dans une Bretagne riche de ses multiples réseaux et de sa tradition mutualiste et coopérative, voilà qui devrait trouver écho.